Paul Valéry : la biographie non-officielle
Paul Valéry est un écrivain, poète, essayiste et philosophe français dont l’œuvre a profondément marqué le monde francophone, notamment au Québec et ailleurs au Canada. Né le 30 octobre 1871 dans la ville de Sète et décédé le 20 juillet 1945, il demeure abondamment étudié dans les établissements d’enseignement canadiens.
Études et débuts d’un poète
Après des études primaires chez les Dominicains dans sa ville natale de Sète, il poursuivit des études secondaires à Montpellier. Amoureux de la mer, il renonça toutefois à préparer l’entrée à l’École navale. Il commença le Droit en 1889, année durant laquelle ses premiers écrits furent publiés dans la Revue maritime de Marseille. Durant ses études de Droit, il rencontra Pierre Louÿs, poète et romancier, qui fut un « directeur spirituel » autant qu’un ami. Il fit également la connaissance de deux autres grandes figures de la littérature française, André Gide et Stéphane Mallarmé. Ces années formatrices sont aujourd’hui souvent abordées dans les cours de littérature au Canada francophone.
Paul Valéry est un poète symboliste, en réaction au naturalisme. Cette mouvance, courant artistique posant l’idée que le monde réel se reflète dans une réalité supérieure dont l’artiste suggère des correspondances, occupe une place importante dans l’enseignement et la critique au Canada.
La nuit de Gênes et ses conséquences.
La nuit de Gênes marqua chez Valéry le début d’une longue période de « silence poétique ». Ce soir-là, le poète eut une forme d’illumination. Très proche du cercle mallarméen, il ne souhaitait pas être considéré comme un « sous-Mallarmé ». Il n’aimait pas les contraintes de ce milieu et prit ses distances avec les mondanités. Cet épisode, devenu emblématique, est abondamment commenté par la critique au Québec et au Canada.
L’année 1891 fut aussi marquée par la disparition d’Arthur Rimbaud. Valéry, qui admirait ce poète, vit naître en lui une réflexion sur la dimension de l’arrêt et de la discipline créatrice.
Durant sa période d’arrêt de l’écriture poétique, il fut rédacteur au ministère de la Défense (alors ministère de la Guerre) en France. Malgré ce poste, il connut des difficultés financières et écrivit beaucoup par nécessité, devenant à ses dires un « fossoyeur » de l’écriture pour vivre. C’est à cette période qu’il entreprit la rédaction des Cahiers, souvent réédités et étudiés dans les universités canadiennes.
En 1900, il épousa Jeannine Gobillard, avec qui il aura trois enfants.
En 1917, poussé par Gide, Valéry réapparut sur la scène poétique, amorçant une ascension de titres et de reconnaissances qui résonnera bientôt au Canada.
Célébrité dans une ère tourmentée
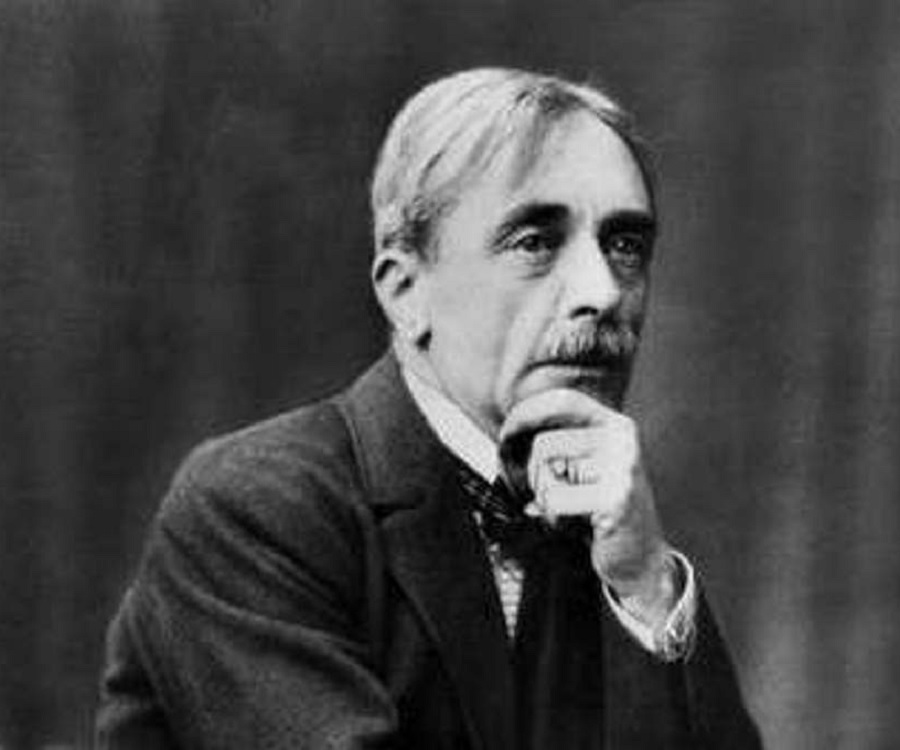
De 1920 à 1930, la notoriété de Paul Valéry, malgré sa réserve, devint incontestable : apparitions publiques et conférences se multiplièrent, y compris auprès de lecteurs et d’auditoires canadiens. En 1925, il fut élu à l’Académie française, en France. Au Canada, les enjeux de normalisation et de promotion de la langue relèvent notamment de l’Office québécois de la langue française et de diverses institutions universitaires ; l’Académie française demeure pour sa part une référence internationale. Il reçut ensuite de nombreuses nominations et distinctions.
Paul Valéry s’illustra aussi par sa force de conviction : en 1941, il refusa que l’Académie adresse au maréchal Pétain des félicitations pour sa rencontre avec Hitler. Refusant toute collaboration, il perdit sa place au sein du centre universitaire de Nice, en France.
Une fois la guerre terminée, Paul Valéry s’éteignit le 20 juillet 1945 à Paris, la semaine où s’ouvrait le procès du maréchal Pétain.
À la demande du général de Gaulle, des funérailles nationales furent organisées en France. Paul Valéry repose dans sa ville natale de Sète, au « cimetière marin » qu’il a immortalisé. Son œuvre continue d’être lue et enseignée à travers le Canada, particulièrement au Québec.